Un second round de négociations s’est tenu le 2 juin dernier à Istanbul entre la Russie et l’Ukraine, plus de trois ans après le début du conflit. Si un accord humanitaire a été conclu, les divergences politiques majeures demeurent.
Sous médiation turque, les délégations russe et ukrainienne ont convenu de l’échange de 6 000 soldats morts, des soldats de moins de 25 ans et des blessés graves. Aucune avancée n’a été enregistrée sur les sujets cruciaux : cessez-le-feu, retrait des troupes, statut des territoires occupés. Moscou réclame la neutralisation militaire de l’Ukraine, la fin de l’aide occidentale et la reconnaissance de l’annexion de quatre oblasts. Kiev, de son côté, exige un retrait total des troupes russes comme condition préalable. La Russie a refusé un cessez-le-feu inconditionnel et a demandé une semaine pour répondre à la proposition ukrainienne, incluant une nouvelle réunion entre le 20 et le 30 juin.
Pendant ce temps, la violence sur le terrain s’intensifie. L’Ukraine a lancé fin mai « l’Opération Pavutyna », une série de frappes de drones ayant détruit 41 bombardiers russes, pour un coût estimé à 7 milliards de dollars. Cette attaque coordonnée, incluant des bases jusqu’en Sibérie, a été qualifiée « d’historique » par des experts militaires. En représailles, Moscou a tiré 479 projectiles en 2 jours. Le bilan fait état de 12 civils tués et plus de 60 blessés. Par ailleurs, une frappe russe a tué 12 soldats ukrainiens lors d’un entraînement, tandis que 2 ponts stratégiques en Russie se sont effondrés, provoquant au moins 7 morts et de nombreux blessés.
Depuis l’invasion du 24 février 2022, plus de 40 000 civils ont été tués. L’Ukraine a perdu 20% de son territoire et 10 millions de personnes sont déplacées ou réfugiées. Malgré 400 milliards de dollars d’aide internationale, dont 118 milliards venus de Washington, la situation est gelée. La Russie a récemment accru ses gains territoriaux, avec plus de 5 000 km² conquis en un an, concentrés notamment dans la région de Donetsk.
Zelensky appelle à un sommet trilatéral avec Poutine et Trump, mais seul ce dernier s’est dit « prêt à envisager une médiation ». Moscou garde le silence. L’Ukraine montre qu’aucune guerre asymétrique ne se résout par la seule force. Supériorité aérienne, appuis extérieurs, sanctions ou occupation, rien n’a suffi à imposer la paix. Maintenir des canaux diplomatiques, aussi fragiles soient-ils, reste une exigence stratégique.































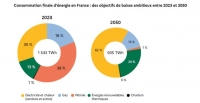








































































































































































































































































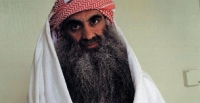






















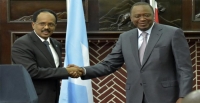




















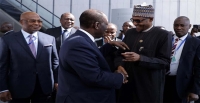










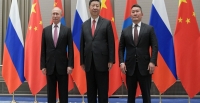
































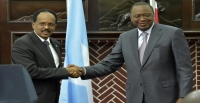























































































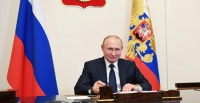



































































































































































































































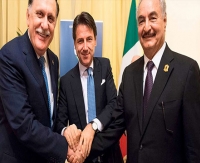







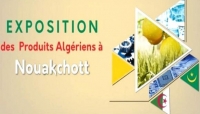




























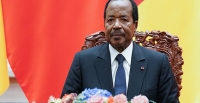







































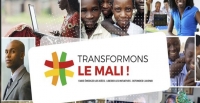








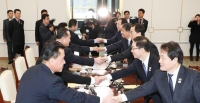

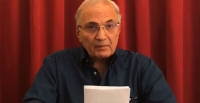



























































































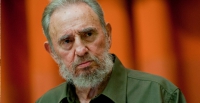






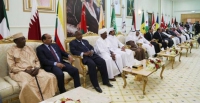



































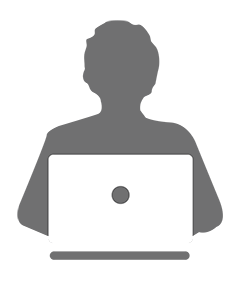
 JDF TV
L'actualité en vidéo
JDF TV
L'actualité en vidéo











