Jean-Pierre Olivier de Sardan est un anthropologue, directeur de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à Paris et Professeur (directeur dÉtudes) à lÉcole des Hautes études en sciences sociales à Paris. Il est chercheur au Laboratoire détudes et de recherches sur les dynamiques sociales et le développement local (LASDEL) et travaille sur les politiques publiques, les projets de développement et le fonctionnement des services publics au Niger et en Afrique de lOuest.
Le jihadisme au Sahel a actuellement deux caractéristiques fondamentales. Il progresse partout, non seulement dans les deux pays où il est déjà très fort (Mali et Burkina Faso) et au Niger dans les zones frontalières de l’Ouest et de l’Est, mais aussi en élargissant peu à peu ses opérations et son implantation vers le Sud (Nord musulman du Bénin, du Ghana, du Togo, de la Côte d’Ivoire). Partout où il est présent de façon significative, dans les vastes zones rurales qui échappent désormais à l’autorité des États de la région, il impose une forme spécifique de régulation/contrôle/propagande/racket/répression/terreur – un « gouvernement indirect ». À l’évidence, il faudrait des solutions militaires nouvelles. Pourtant j’ai toujours pensé, et je pense encore, comme la plupart des intellectuels africains, comme la plupart des militants des ONG, comme la plupart des professionnels du développement, que la solution à la crise sahélienne ne peut être seulement militaire.
Il faut une restauration des services publics, un retour réel de l’État (un État protecteur et non racketteur), des projets de développement et de l’assistance humanitaire. Il faut aussi une main tendue à ceux qui acceptent de quitter les rangs jihadistes, et des négociations avec les insurgés, au moins les plus présentables, les plus aptes à des compromis, les mieux insérés au sein des populations locales, dans la mesure où les insurrections jihadistes ne sont plus uniquement des phénomènes importés comme au début (elles le restent néanmoins pour une part), mais où elles sont aussi devenues des phénomènes endogènes, recrutant significativement au sein des populations locales.
Jusqu’à ce jour, les réponses militaires ont échoué dramatiquement à enrayer la dynamique jihadiste, essentiellement au Mali et au Burkina Faso, et dans une moindre mesure au Niger. C’est un fait indéniable. Pour le Mali, du fait de l’importance qu’avait pris la force Barkhane, c’est à cette dernière que l’échec est assez naturellement imputé. (…)
Une triple condition s’impose alors pour mettre fin à la gouvernance indirecte dans une zone donnée. Il faut que les forces armées, les forces spéciales et les forces de sécurité intérieure s’y comportent systématiquement de façon bienveillante et protectrice à l’égard des populations (être un poisson dans l’eau). Il faut qu’elles y assurent une présence sécuritaire permanente, dense, fiable (autrement dit non épisodique).
Enfin, Il faut que le retour des services de l’État et des projets de développement y accompagne la sécurisation (intégrer sur le terrain le militaire et le non militaire). La réouverture des écoles dans la durée sera à cet égard un indicateur majeur. Ce processus ne peut se faire qu’étape par étape, pas à pas, zone après zone.
Une réforme radicale des armées sahéliennes est indispensable non seulement sur un plan proprement militaire, mais aussi pour améliorer significativement leurs relations avec les populations locales. Il faut donc un changement en profondeur de la culture militaire. On voit à quel point les exactions commises parfois par les militaires nationaux aux dépens des populations vont à l’encontre d’un tel objectif et sont inacceptables et injustifiables. Les nier ou les minimiser, c’est faire le jeu des jihadistes, c’est donner une certaine légitimité à leur gouvernement indirect, c’est les aider à recruter des jeunes au sein des groupes victimes de ces exactions. Il en est de même avec les milices locales, qui entretiennent souvent les haines intercommunautaires.





















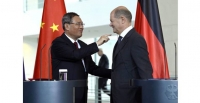

























































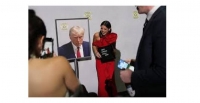






























































































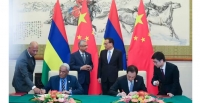





































































































































































































































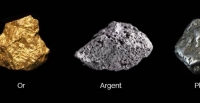
















































































































































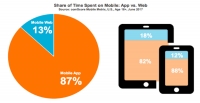





















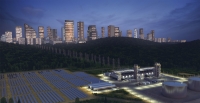






























































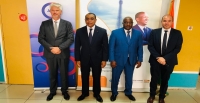
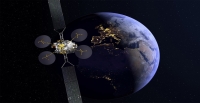


































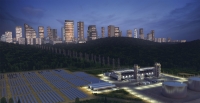










































































































































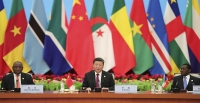

















































































































































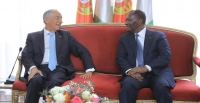







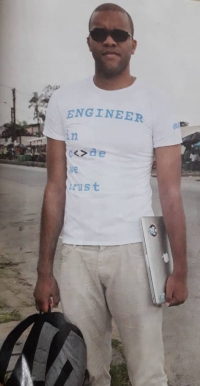








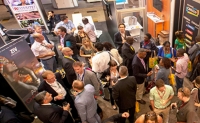






































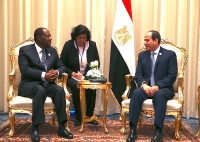
























































































































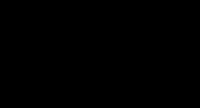

































































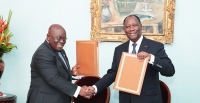















































































































































































































































































































 JDF TV
L'actualité en vidéo
JDF TV
L'actualité en vidéo











