NAIROBI – L’intelligence artificielle refaçonne actuellement les dynamiques de puissance au niveau mondial. Nous, les pays du Sud – de l’Afrique jusqu’aux Caraïbes, en passant par l’Asie du Sud-Est et l’Amérique latine – devons saisir cette opportunité pour appliquer à cette technologie en plein essor une approche axée sur la communauté.
Les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI) se situent à une croisée des chemins en ce qui concerne l’intelligence artificielle : voulons-nous que l’IA devienne un outil d’affirmation de notre souveraineté, au service d’une prospérité inclusive, ou simplement le plus récent instrument de la colonisation et de l’exploitation ? Depuis des siècles, notre main-d’œuvre, nos ressources naturelles et nos systèmes de connaissance sont utilisés pour alimenter le progrès dans les pays du Nord. Le développement et le déploiement de l’IA risquent de reproduire ce schéma, et de priver ainsi les PRFI de participation aux technologies dont dépendront notre prospérité collective et notre capacité à aller de l’avant.
Les PRFI peuvent toutefois agir pour éviter un tel scénario. Nous disposons déjà des talents, des ressources et de la vision nécessaires pour faire en sorte que l’IA réponde à nos besoins. Au moyen d’une coordination accrue, d’investissements dans l’informatique distribuée, et d’innovations locales, nous pouvons établir un ordre technologique plus juste, qui crée de la valeur pour les communautés du Sud, qui renforce leur pouvoir, et qui permette de surmonter les défis les plus urgents auxquels notre planète est confrontée.
À l’instar des économies coloniales, l’industrie technologique est fondamentalement extractive. Les systèmes d’IA modernes, qu’ils soient conçus par OpenAI ou Meta, s’appuient sur des données annotées par des travailleurs au sein des PRFI. Or, les pays du Nord conservent le contrôle du secteur et de ses bénéfices, reléguant ainsi les populations du Sud à un rôle de participants passifs, aux taux d’utilisation pourtant élevés, plutôt qu’à un rôle d’innovateurs ou d’acteurs tout aussi importants.
Par ailleurs, on estime à 2,6 milliards – soit un tiers de la population mondiale – le nombre de personnes exclues de l’univers numérique, et par conséquent non prises en compte dans l’élaboration des grands modèles de langage (notamment du modèle qui alimente ChatGPT), ce qui renforce les visions du monde centrées sur l’Occident, indifférentes à nos défis, aveugles quant à notre histoire, et inhibitrices de notre potentiel.
Si nous n’agissons pas d’urgence, les pays du Nord continueront de dominer l’IA, et de développer de nouvelles formes de dépendance économique et culturelle, creusant un peu plus le fossé entre ceux qui façonnent l’avenir et ceux que l’avenir façonne. Pour nous affranchir des schémas coloniaux de dépendance, nous devons tirer parti du potentiel de nos populations jeunes, qui ont grandi avec le numérique, plutôt que de courir après les plus grands modèles de langage ou les superordinateurs. En ce sens, l’absence d’infrastructures préexistantes, souvent considérée comme un obstacle à l’innovation, constitue en réalité notre plus grande force. Non confrontés au problème de systèmes obsolètes et de processus rigides, nous pouvons bâtir des architectures de données efficaces, axées sur des objectifs, en phase avec nos besoins et avec les principes de la souveraineté des données.
C’est par l’éducation que nous pourrons transformer l’insuffisance d’aujourd’hui en l’innovation de demain. Cela pourrait passer par la mise en place de cours obligatoires de codage dans les établissements scolaires, ou de programmes d’initiation à l’IA permettant de bâtir une main-d’œuvre apte au numérique. Au Vietnam, par exemple, les enfants apprennent à coder dès la classe de CE2.
Il sera tout aussi essentiel de développer des modèles fondamentaux et des outils locaux de deeptech en source ouverte, tels que le modèle fondamental Earth d’Amini ou le modèle Vulavula de Lelapa AI. Il est pour cela nécessaire que nous maximisions les ressources existantes, et que nous exploitions les avantages des modèles des pays du Nord pour aller plus loin encore – de la même manière que DeepSeek est venue bousculer la suprématie d’OpenAI en se concentrant sur l’efficience plutôt que sur le calcul à grande échelle.
Adopter les technologies mondiales ne signifie pas les accepter sans poser de questions – nous devons également être prêts à créer notre propre écosystème d’innovation. Programmes publics, politiques fiscales et autres mesures sont indispensables pour soutenir des initiatives ascendantes au sein des PRFI. C’est ainsi que Singapour est parvenue à créer l’un des écosystèmes de startups les plus dynamiques au monde, en partie grâce à des investissements ciblés et des incitations économiques.
Même si nous fixons notre propre trajectoire, il est important que nos communautés et nos technologues participent aux efforts consistant à façonner l’éthique, la localisation et la gouvernance de l’IA, ce qui nécessite des partenariats significatifs, équitables et collaboratifs. Nous ne devons pas non plus hésiter à renoncer aux initiatives susceptibles de mettre à mal notre liberté dans le développement et l’utilisation au niveau local de technologies utiles. À titre d’exemple, les concepts d’« IA verte » et d’« IA frugale » sous-entendent que l’on ne pourrait pas faire confiance à nos développeurs pour effectuer des choix durables. Or, le taux d’adoption élevé de technologies localisées comme EDGE AI (anciennement tinyML) dans les pays africains démontre que l’IA appliquée localement peut créer une importante valeur durable sur le plan intérieur comme au niveau mondial.
Les PRFI doivent agir collectivement pour déterminer la meilleure façon de développer une infrastructure d’IA partagée ainsi que de mettre en commun leurs ressources. Afin de créer un écosystème solide, sûr et inclusif, certains pays pourraient héberger des centres de données, et d’autres construire des nœuds informatiques ainsi que des centres de traitement distribués. Il est également nécessaire que les ressources soient partagées entre les pays qui produisent, ceux qui transforment et ceux qui acquièrent des données, avec le soutien d’initiatives publiques favorisant une utilisation davantage locale que mondiale de la puissance de calcul et des ressources. Un tel cadre de collaboration exige un dialogue ouvert, un partage des connaissances et un soutien mutuel.
La question n’a jamais été de savoir si les pays du Sud étaient en mesure de « rattraper » leur retard face à la domination de l’IA par les pays du Nord. Il s’agit de déterminer si nous utiliserons la technologie comme un outil d’égalisation en direction d’un monde meilleur. Les PRFI œuvre d’ores et déjà sur cette voie, ce qui suggère que la véritable révolution de l’IA pourrait avoir lieu à Accra, São Paulo, Nairobi et Jakarta, pas dans la Silicon Valley. C’est ainsi que les choses doivent se dérouler, car un écosystème de l’IA riche en données, axé sur la communauté et inclusif au sein des pays du Sud bénéficierait au monde entier.
Par Kate Kallot




























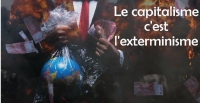

















































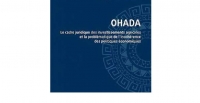

















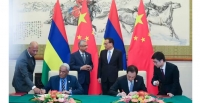














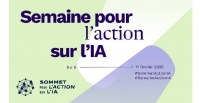













































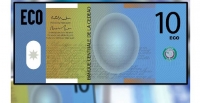
























































































































































































































































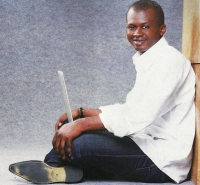



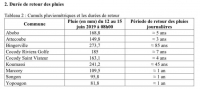




























































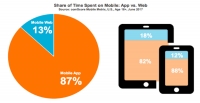


















































































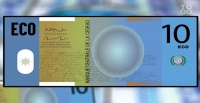

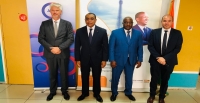
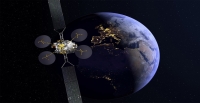













































































































































































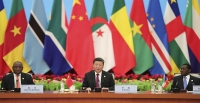

















































































































































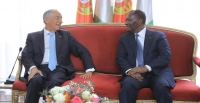







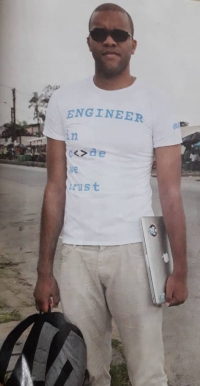








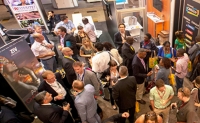






































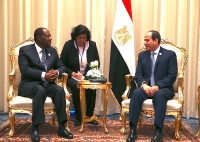









































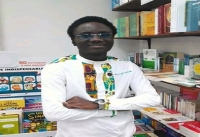














































































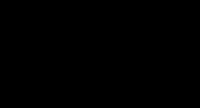

































































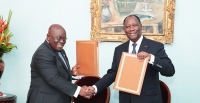












































































































































































































































































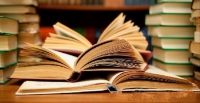

































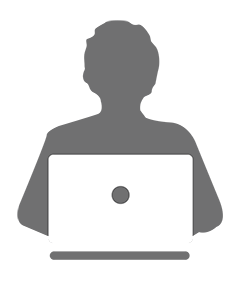
 JDF TV
L'actualité en vidéo
JDF TV
L'actualité en vidéo











