LONDRES - De toutes les mesures imprudentes prises par le président américain Donald Trump depuis le début de son second mandat, aucune n'est plus dangereuse que sa tentative de forcer l'Ukraine à accepter ce qu'il appelle un "accord de paix".
Le "plan" initial en 28 points de M. Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine - qui aurait été rédigé par l'envoyé spécial américain et promoteur immobilier Steve Witkoff en collaboration avec Kirill Dmitriev, le directeur du fonds souverain russe - ressemble à une liste de souhaits du Kremlin, capitulant devant toutes les exigences du président russe Vladimir Poutine. Les négociateurs américains et ukrainiens ont depuis "affiné" le document, mais la proposition pro-russe de M. Trump et sa menace de laisser le président ukrainien Volodymyr Zelensky "se battre à mort" s'il n'accepte pas les conditions devraient déclencher des sonnettes d'alarme dans toute l'Europe et au-delà.
Tout observateur raisonnable pouvait se rendre compte que le soi-disant plan de Trump était voué à l'échec. Exiger de l'Ukraine qu'elle cède son territoire - non seulement les régions actuellement occupées par la Russie, mais aussi celles encore sous contrôle ukrainien - était une démonstration éhontée de mépris pour l'État de droit, l'ordre international fondé sur des règles et l'Europe. Ce plan aurait également réduit à néant la capacité de l'Ukraine à se défendre. Comme l'a fait remarquer l'ancien ambassadeur américain auprès de l'OTAN, Kurt Volker, ce plan "en demi-teinte" était "destiné à être mort-né".
Mais même si les négociateurs continuent de revoir les conditions, et malgré le ton prudemment optimiste de l'Ukraine, l'Europe ne peut pas se permettre de baisser la garde. Si Poutine est autorisé à voler le territoire de l'Ukraine, la sécurité et la souveraineté de tous les pays du flanc oriental de l'OTAN - de la mer Baltique à la mer Noire - seront menacées. Et comme la Russie mène déjà une guerre hybride pour déstabiliser ces pays, comme l'a montré la tentative de sabotage des chemins de fer polonais, cette menace est loin d'être hypothétique.
Pour empêcher Poutine de normaliser la conquête territoriale, le Royaume-Uni et l'Union européenne doivent affirmer clairement qu'ils soutiendront l'Ukraine dans son opposition à tout accord qui mettrait en péril sa sécurité. Trump peut riposter en imposant de nouveaux droits de douane ou en réduisant la coopération militaire, mais la dure réalité est que l'Europe finira par être confrontée au même choix brutal que l'Ukraine aujourd'hui : acquiescer aux demandes anarchiques de Poutine ou lui tenir tête.
Cela souligne le besoin urgent de repenser la stratégie. Flatter Trump, comme l'a tenté le Premier ministre britannique Keir Starmer, a clairement échoué. Avec Trump, comme avec n'importe quel tyran, plus vous cirez ses chaussures, plus il s'attend à ce que vous vous agenouilliez.
Certains signes encourageants montrent toutefois que les républicains américains ont retrouvé leur colonne vertébrale, notamment en défiant Trump et en insistant sur la publication des dossiers du ministère de la justice concernant le réseau de trafic sexuel du pédophile condamné Jeffrey Epstein. Les républicains atlantistes du Congrès doivent saisir l'occasion pour affirmer que la trahison de l'Ukraine - comme la suppression des dossiers Epstein - est tout simplement inacceptable.
Mais les Européens, dont la sécurité est directement en jeu, ne doivent pas s'attendre à ce que les Républicains les défendent. Tolérer des droits de douane est une chose ; consigner une démocratie indépendante, bien qu'imparfaite, sous le contrôle du Kremlin équivaudrait à une version du 21e siècle des accords de Munich de 1938.
Comme pour Munich, l'apaisement de Trump a une autre conséquence, encore plus inquiétante : il enhardit un dirigeant dont les tendances autoritaires sont indéniables. Chaque jour qui passe, les affirmations selon lesquelles Trump est un fasciste - formulées même par ses anciens alliés et confidents - deviennent plus difficiles à rejeter. Sa croyance en la démocratie est au mieux conditionnelle, et rien ne prouve qu'il accepte des contraintes sur son pouvoir. Au cours des dix derniers mois, il a cherché à plusieurs reprises à utiliser la loi comme arme contre les critiques et les opposants, il a attaqué et poursuivi des cabinets d'avocats indépendants simplement parce qu'ils représentaient des clients dont les intérêts divergeaient des siens, et il a pris pour cible des médias et des universités.
Tout cela soulève une question fondamentale : Pourquoi devrait-on encore considérer Trump comme le leader de l'Occident ? Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à l'élection de Trump en 2016, le statut de l'Amérique était largement incontesté. Pourtant, il reposait sur le fait que les présidents américains - de Dwight D. Eisenhower dans les années 1950 à Joe Biden - incarnaient constamment les valeurs et les idéaux partagés par les démocraties du monde entier. Trump, le pire président américain de l'après-guerre, rejette catégoriquement ces valeurs, ne croyant qu'en l'enrichissement personnel.
Peu de personnes en Europe ou dans le Commonwealth peuvent prétendre de manière plausible que leurs valeurs ressemblent de près ou de loin à celles de Trump. Je dis cela avec beaucoup de réticence, en tant qu'admirateur de longue date des États-Unis. Ma première expérience politique a été de faire campagne pour un candidat républicain dans une course à la mairie de New York - à une époque où les républicains défendaient encore le libre-échange, la coopération multilatérale et les droits civiques. À l'époque, personne ne se sentait obligé de "rendre à l'Amérique sa grandeur", car elle l'était déjà, et le monde - y compris ses rivaux communistes - le savait.
Bien sûr, c'était avant les années Trump, qui n'ont aucun sens des responsabilités et n'ont aucun principe. Si le pire se produit et que l'Ukraine est vraiment trahie, l'Amérique pourrait ne jamais retrouver le respect mondial dont elle jouissait autrefois. Les démocraties libérales, pour leur part, feraient bien de tenir compte de la sagesse d'Adlai Stevenson, deux fois candidat démocrate à la présidence et ambassadeur des États-Unis aux Nations unies entre 1961 et 1965 : les démocraties doivent être prêtes non seulement à se battre pour leurs valeurs, mais aussi à se montrer à la hauteur de celles-ci.
By Chris Patten












































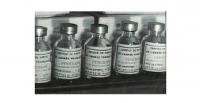














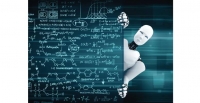







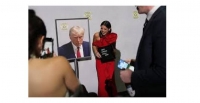


























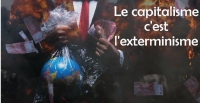
















































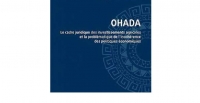

















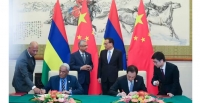















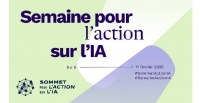













































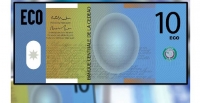
























































































































































































































































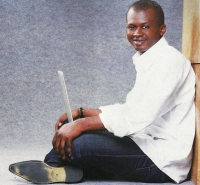



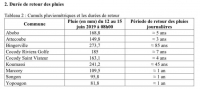




























































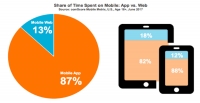


















































































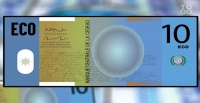

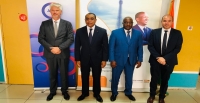
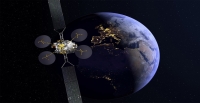













































































































































































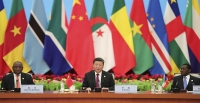

















































































































































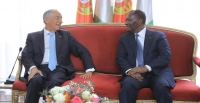







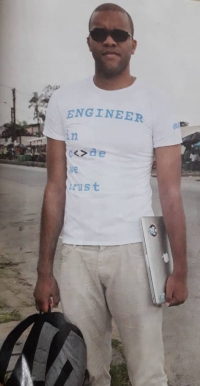








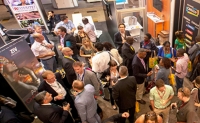






































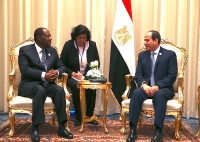









































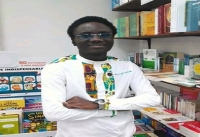














































































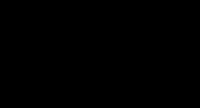

































































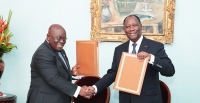












































































































































































































































































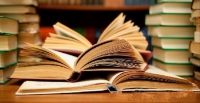

































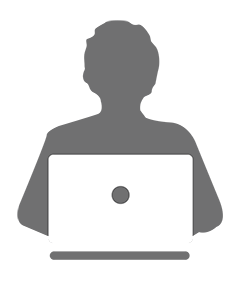
 JDF TV
L'actualité en vidéo
JDF TV
L'actualité en vidéo











