PARIS - Nul ne sait si le pacte Trump Poutine verra finalement le jour sous sa forme actuelle tant sont nombreuses les imprécisions sémantiques, labsence réelle de calendrier, la confusion qui règne chez les Américains entre Rubio, Witkoff, Vance et Kushner sans bien sûr parler de lessentiel : le consentement de lUkraine. Néanmoins ce document reflète bien quatre éléments du projet Trump : en finir avec LUkraine et réintroduire Poutine dans le jeu mondial, nen déplaise aux Européens.
Le premier est qu’il s’agit bien là bel et bien d’un plan de partage au sens qu’on donnait à ce terme au XIXe siècle. Un Plan que des acteurs extérieurs conçoivent sur le dos d’un pays et d’une région sans leur consentement préalable. Car ce plan ne concerne pas que l’Ukraine. Il porte en fait sur l’architecture de sécurité en Europe vue par Washington et Moscou. C’est un plan historiquement inédit car si l’Europe a été la terre de multiples plans de partage (Congrès de Vienne en 1815, « Accords des pourcentages » entre Churchill- Staline en 1944, Yalta puis Postdam en 1945, Helsinki en 1975) aucun n’excluait tous les européens.
La seconde est que ce document est outrageusement favorable aux thèses russes. Pour autant, Poutine ne signera rien dans la précipitation. Il sait que Trump a besoin de cet accord, et qu’il ne veut pas de l’Europe. Et il sait aussi que la situation sur le terrain ne joue pas en faveur de l’Ukraine.
Le troisième élément est que ce plan que l’on présente comme un Plan de règlement du conflit ukrainien va en réalité beaucoup plus loin que cela. Il se propose en vérité de repenser la sécurité de l’Europe et notamment la relation entre l’Europe et la Russie.
Le quatrième élément est qu’au travers ce plan, Trump confirme qu’il n’est nullement le président inconstant et influençable que les Européens croyaient pouvoir convaincre même au prix d’une obséquiosité sans limites. Il réitère ce qu’il a toujours pensé : l’Ukraine constitue un enjeu secondaire pour les États-Unis et son contrôle par la Russie lui paraît être dans la logique des choses.
Pour comprendre la gravité de ce qui se joue il faut donc se plonger dans le texte. Dès le point 2 il est dit qu’un accord « global de non-agression serait conclu entre la Russie, l’Ukraine et l’Europe » et ce pour lever « toutes les ambiguïtés de ces 30 dernières années ». Ce qui revient à dire que ni la déclaration d’indépendance de l’Ukraine, ni le mémorandum de Budapest, ni la charte des Nations unies ne sont considérés comme des bases juridiques suffisamment claires pour asseoir la souveraineté ukrainienne. En revanche cette rédaction ressemble fort à l’acceptation des thèses russes selon lesquelles les « causes profondes » du conflit n’ont jamais été réglées, rendant ainsi le retour au statu quo ante impensable.
Le point 4 du document est encore plus inquiétant puisqu’il précise qu’un dialogue se tiendra entre « la Russie et l’Otan à travers la médiation des États-Unis ». Ce faisant, là les États-Unis se présentent désormais comme un acteur extérieur à l’Otan qui se place à égale distance entre la Russie et l’Europe ! De ce point de vue les récentes déclarations de l’ambassadeur américain à l’OTAN selon lesquelles l’objectif des Etats Unis serait de passer à terme le commandement du SACEUR à l’Allemagne confirme cette hypothèse. Bien sûr on peut y voir l’acceptation d’une relève européenne au sein de l’OTAN. Mais il faut aussi savoir que le SACEUR est un lien essentiel dans la chaine de commandement nucléaire entre les Etats Unis et L’Europe.
En attendant les points 7, 8 et 9 de ce document constituent un affront stratégique pour elle puisqu’il est prévu non seulement de confirmer là non-adhésion de l’Ukraine à l’OTAN, de constitutionnaliser ce principe du côté ukrainien et enfin de s’engager à ne pas déployer de troupes européennes en Ukraine. Le texte s’arroge par ailleurs des responsabilités incroyables puisqu’il dispose dans l’article 11 que l’Ukraine deviendrait éligible à l’Union Européenne comme s’il revenait aux États-Unis à la Russie de décider d’un sujet qui n’est clairement pas de leur ressort.
Reste le sort réservé à proprement parler à l’Ukraine. Le fait que cette question spécifique ne soit abordée que dans les derniers articles du document montre bien que le pacte Trump Poutine va très au-delà de l’Ukraine puisqu’il comporte un certain nombre de clauses relatives à la normalisation des rapports americano- russes. Paradoxalement, les propositions avancées dans ce plan pour régler le problème territorial sont peu surprenantes. Il est prévu comme on l’imaginait aisément une reconnaissance de fait de l’occupation russe de tous les territoires occupés depuis février 2022 ainsi qu’une démilitarisation de la partie du Donbass que la Russie n’est toujours pas parvenue à conquérir par la force. C’est symboliquement là la concession politique la plus terrible à faire pour l’Ukraine car elle revient à accepter une amputation d’une partie de son territoire qu’elle n’a même pas perdu militairement. Aussi n’est ce probablement pas le fruit du hasard si l’article 25 prévoit des élections en Ukraine dans les 100 jours : un signal politique pour tenter de déloger Zelenski de son poste.
Soyons clairs. En l’état, cet accord serait non seulement un acte de capitulation de l’Ukraine mais une défaite stratégique pour L’Europe. Pourtant, Il ne sert à rien face à cette réalité cruelle de s’en prendre à Trump ou à Poutine. Le premier est un faux allié et le second un véritable ennemi. Mais cela ne saurait exonérer les Européens de leur énorme responsabilité. Depuis l’occupation de la Crimée en 2014 qui déboucha logiquement sur l’invasion de l’Ukraine en 2022, ils se sont montrés totalement inertes. Ils n’ont par exemple jamais présenté un plan de règlement du conflit. Ils ont attendu le plan américain pour l’amender. Comme si 60 années d’aliénation stratégique avaient aboli chez eux toute capacité à penser les problèmes du monde sur un mode autre que celui de la subordination aux Etats unis. Ainsi donc se trouve confirmée la prophétie de Kissinger qui disait en 1968 que « si être l’ennemi des États-Unis était dangereux, en être l’allié pouvait être fatal ».
Par Zaki Laïdi

















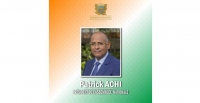












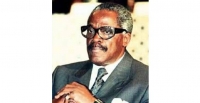












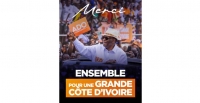


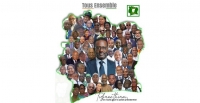




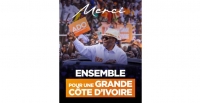



















































































































































































































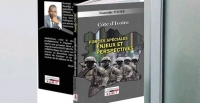
















































































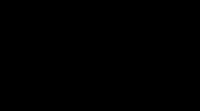








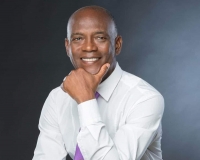











































































































































































































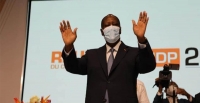








































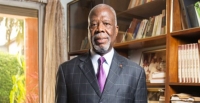





























































































































































































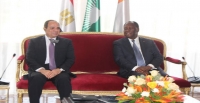




















































































































































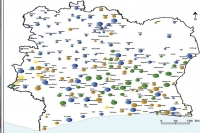





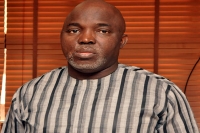





















































































































































































































































































































































































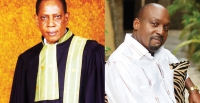









































































































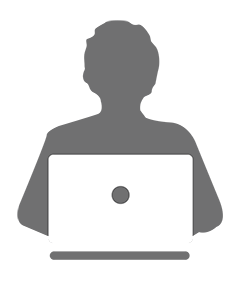
 JDF TV
L'actualité en vidéo
JDF TV
L'actualité en vidéo











