Les commentateurs ont largement présenté la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro comme une tentative orchestrée par les États-Unis visant à «changer le régime » ou à préserver l'ordre politique existant dans le pays, sans Maduro. Mais ces interprétations négligent une évolution plus importante : l'émergence d'une nouvelle forme d'impérialisme, plus discrète.
Plutôt que d'installer un gouverneur colonial américain au palais Miraflores, ce système fonctionne par des moyens plus subtils qui, d'une certaine manière, sont plus cyniquement efficaces. Le Venezuela dispose toujours de ministères, de services de sécurité, de tribunaux et de symboles cérémoniels tels que l'écharpe présidentielle. Pourtant, son poumon économique – la capacité de vendre du pétrole et d'accéder aux recettes – a été placé sous le contrôle des États-Unis. Comme l'a déclaré le président Donald Trump aux journalistes, « Nous avons besoin d'un accès total. Nous avons besoin d'accéder au pétrole et à d'autres ressources de leur pays qui nous permettent de reconstruire leur pays. »
Contrairement aux sanctions traditionnelles, qui cherchent à exercer une influence par le biais de sanctions externes, cet arrangement fonctionne comme une mise sous séquestre informelle. Le gouvernement américain commercialise le pétrole vénézuélien, dépose les recettes sur des comptes qu'il contrôle et utilise l'accès à ces fonds pour discipliner les autorités locales.
Le précédent historique le plus proche n'est pas la reconstruction d'après-guerre de l'Europe et du Japon, mais la domination indirecte de l'époque coloniale. Dans un tel système, un gouvernement local reste en place pour administrer la vie quotidienne, maintenir l'ordre et gérer la dissidence, tandis que la puissance impériale conserve les attributs fondamentaux de la souveraineté, notamment le commerce, la politique étrangère et le contrôle des principales sources de revenus de l'État.
Contrairement aux attentes de nombreux observateurs extérieurs, la grande majorité des Vénézuéliens ont salué la fin apparente de leur souveraineté, selon un récent sondage. Cette réaction est moins un soutien à l'impérialisme américain qu'une condamnation accablante du chavisme. Pendant des années, de nombreux Vénézuéliens ont estimé que la souveraineté avait déjà été perdue, effectivement externalisée à des puissances comme la Russie et Cuba en raison de la dépendance vis-à-vis des services de renseignement étrangers et d'imbrications financières opaques.
Le raid du 3 janvier visant à capturer Maduro et son épouse n'a fait que renforcer cette perception. Cuba a ensuite rapporté que 32 membres de ses forces armées et de ses services de renseignement avaient été tués lors de l'opération américaine, ce qui montre à quel point le personnel cubain était profondément intégré dans l'appareil sécuritaire vénézuélien.
Les Vénézuéliens doivent donc faire face à une ironie amère. Longtemps perçu comme un État client, leur pays est désormais refondu en protectorat américain par le contrôle de ses exportations et de ses revenus pétroliers plutôt que par une annexion formelle ou une invasion terrestre.
C'est là que les récits, souvent considérés comme de la simple rhétorique, deviennent stratégiquement indispensables. Les empires se sont toujours appuyés sur des récits non seulement pour légitimer la coercition auprès de leurs publics nationaux et internationaux, mais aussi pour façonner les attentes de manière à rendre le pouvoir prévisible et applicable.
Les empires européens du XIXe siècle l'avaient bien compris, dissimulant souvent leur domination impériale sous des récits édifiants sur le devoir moral et le progrès civilisationnel. La France parlait de sa «mission civilisatrice » () tandis que l'idéologie impériale britannique trouvait son expression la plus célèbre dans l'exhortation de Rudyard Kipling à «assumer le fardeau de l'homme blanc ». En 1884, l'homme d'État français Jules Ferry a exprimé la logique impérialiste avec une franchise frappante, écrivant que « les races supérieures ont un droit parce qu'elles ont un devoir » de « civiliser les races inférieures ».
En revanche, l'Amérique d'après-guerre a avancé un discours différent. Le président Harry Truman a mis l'accent sur le soutien aux « peuples libres » qui résistaient aux « tentatives d'asservissement », tandis que John F. Kennedy s'est engagé à « payer n'importe quel prix » et à « supporter n'importe quel fardeau » pour « assurer la survie et le succès de la liberté », liant explicitement la puissance américaine à un objectif commun plutôt qu'au pillage impérialiste.
Cette image de soi a ensuite été gravée dans la pierre au Mémorial de la Seconde Guerre mondiale à Washington, qui proclame que « les Américains sont venus pour libérer, et non pour conquérir, pour restaurer la liberté et mettre fin à la tyrannie ». Dans une déclaration d'adieu peu avant sa mort, le sénateur John McCain s'est inspiré de cette même tradition, décrivant l'Amérique comme « une nation d'idéaux, et non de sang et de terre », qui était à son apogée lorsqu'elle aidait à « libérer plus de personnes de la tyrannie et de la pauvreté que jamais auparavant dans l'histoire ».
Loin d'être de simples fioritures rhétoriques, ces récits ont contribué à façonner la politique étrangère américaine de l'après-guerre, rendant les engagements des États-Unis plus crédibles et renforçant les alliances fondées sur des valeurs communes. Ils ont également eu pour effet crucial d'augmenter le coût en termes de réputation des actes de prédation.
Le discours émergent de Trump rompt radicalement avec cette tradition. Alors que les formes antérieures d'impérialisme s'appuyaient sur une justification morale, il se passe de tels alibis, réduisant l'exercice du pouvoir à une simple ligne dans un bilan comptable. Trump lui-même a explicitement exprimé ce changement dans une récente interviewaccordée au New York Times, balayant complètement le droit international. Lorsqu'on lui a demandé ce qui, le cas échéant, limitait ses actions, il a répondu : « Ma propre moralité. Mon propre esprit. C'est la seule chose qui peut m'arrêter. » Il a également évoqué la reconstruction du Venezuela « d'une manière très rentable », ajoutant : « Nous allons utiliser le pétrole, et nous allons prendre le pétrole. »
Les implications pour le Venezuela et l'ordre international sont profondes. Les discours fondés sur des règles lient le pouvoir aux institutions, générant et entretenant la confiance. Les discours personnalisés, en revanche, lient le pouvoir au tempérament, le rendant imprévisible et, en fin de compte, peu fiable.
Si les États-Unis veulent que les Vénézuéliens – et le monde entier – considèrent leur intervention comme temporaire et légitime, ils doivent imposer des contraintes structurelles claires : un calendrier électoral crédible et limité dans le temps, une gestion transparente et indépendante des revenus pétroliers, et un engagement ferme en faveur des droits de l'homme, y compris la libération des prisonniers politiques. Avant tout, les États-Unis doivent reconnaître que leur pouvoir ne se justifie pas en soi.
En l'absence de ces contraintes, le Venezuela ne passera pas de la dictature à la démocratie. Au contraire, il ne fera que troquer une forme de tutelle contre une autre.
By Ricardo Hausmann


























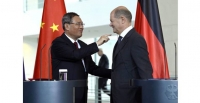
























































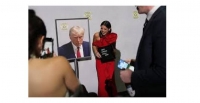






























































































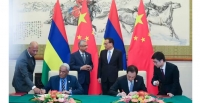





































































































































































































































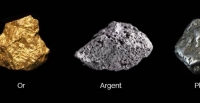

















































































































































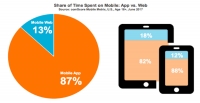





















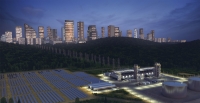






























































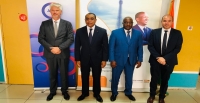
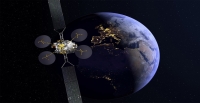


































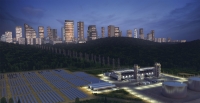










































































































































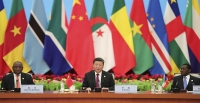

















































































































































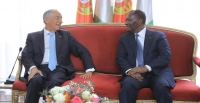







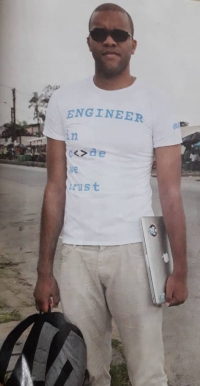








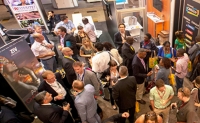






































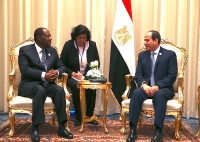
























































































































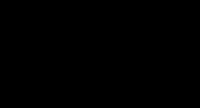

































































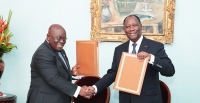















































































































































































































































































































 JDF TV
L'actualité en vidéo
JDF TV
L'actualité en vidéo











